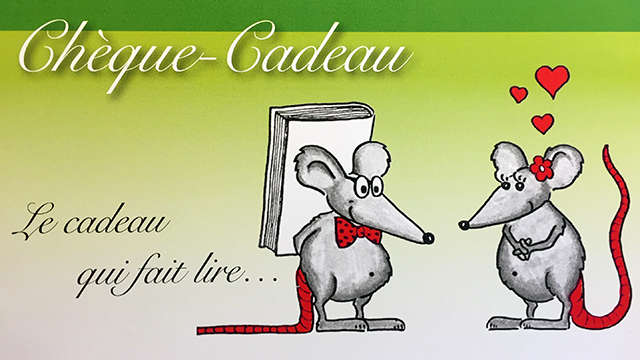La régulation est omniprésente dans le discours économique contemporain. Elle est perçue comme une réponse aux crises des marchés et à la disruption technologique, mais que signifie-t-elle réellement? Contrairement à la réglementation, la régulation incarne un projet politique né dans les années 1930, porté par les pionniers du néolibéralisme. Ceux-ci proposaient un interventionnisme juridique de l’État, distinct du planisme et du fascisme, pour accompagner l’accélération économique et technologique.
Ce modèle s’est affirmé après les chocs pétroliers des années 1970, en valorisant la concurrence et l’innovation comme moteurs du progrès. La régulation devient alors l’outil juridique de cette dynamique, adaptant les normes à la vitesse du marché. Les mouvements sociaux récents, comme les « Gilets jaunes » ou le « Convoi de la liberté », révèlent une tension croissante face à cette logique de la vitesse.
Derrière son apparente neutralité, la régulation est l’instrument du néolibéralisme, promouvant la concurrence par le droit. L’Union européenne en a fait un pilier de son identité, en opposition à l’approche plus libérale (au sens classique) des États-Unis. Cette divergence se manifeste notamment dans le domaine des technologies, où deux visions normatives s’affrontent. Comprendre la régulation, c’est donc éclairer les enjeux idéologiques de notre époque, à l’heure où le populisme tente d’en exploiter les failles.